

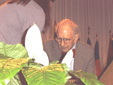

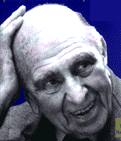

 | 
| 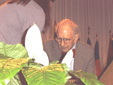 |
 | 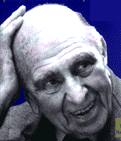 |  | ||||||||
..Janet | ..Alexander | ..Bowlby | ..Cannon | .......Kandel | ......Edelman | ..James | Clérambault | .....Freud | ....Lacan | ...Lebovici | ....Klein | ...Jung | ...Bion |
|
Le site des recherches sur les psychothérapies psychodynamiques |
||||||
Dr Jean-Michel Thurin. Psychiatre -psychanalyste
Expert chargé des psychothérapies psychodynamiques pour le rapport
Tel : 01 48 04 77 70 – mail : jmthurin@internet-medical.com
L’expertise s’est donnée des objectifs ambitieux : répondre
aux neuf questions annoncées dans l’avant-propos. Elle réactive
de nombreuses interrogations concernant l’évaluation des psychothérapies
psychodynamiques, à commencer par celle de la possibilité d’une
telle évaluation. Cette question n’est pas nouvelle. On la retrouve
tout au long d’un siècle d’histoire de la psychanalyse, aux
quatre coins du monde, associée ces dernières décennies
à des enjeux proches de ceux que nous pressentons. Les difficultés
d’une telle entreprise ont été l’objet de multiples
débats autour de très nombreux travaux menés par des cliniciens
chercheurs qui ont tenté de trouver des solutions à des problèmes
qui, initialement, paraissaient insolubles.
Ces tentatives n’ont pas été vaines. Elles ont permis peu
à peu de résoudre ou de contourner les principales difficultés.
Ce travail est présenté dans le chapitre II, à son point
d’achèvement actuel, c’est à dire loin d’être
terminé. Mais les recherches menées, et particulièrement
les plus récentes, dont les protocoles sont présentés dans
ce rapport, confirment qu’il est devenu aujourd’hui possible
d’évaluer les résultats des psychothérapies psychanalytiques
sur des bases à la fois scientifiquement solides et acceptables vis-à-vis
des objectifs spécifiques de ces cures. Ces recherches prennent
en compte dans leur évaluation des résultats le fonctionnement
de la personne dans différentes dimensions et quelques uns au moins des
multiples facteurs impliqués (par exemple, le cadre psychothérapique,
l’usage et les modalités de l’interprétation …).
De fait, , cette expertise devrait encourager les cliniciens et les équipes de recherche à développer des études évaluatives sur les psychothérapies dans ce domaine, en s’appuyant sur des méthodologies qui se sont affinées progressivement. Ces évaluations sont d'autant plus nécessaires qu'elles sont quasiment inexistantes en France.
Il faut cependant insister d’emblée sur les limites et le caractère préliminaire de cette expertise.
D’abord, elle s’est limitée aux résultats suivant un modèle global avant/après, sans prendre en compte les processus, orientation qui est pourtant recommandée dans toutes les recherches qui sont menées actuellement.
Ensuite, la direction de l’expertise – initialement assez ouverte – s’est rapprochée progressivement d’une orientation Evidence Based Medecine (EBM) poussée à l’extrême. Or cette dernière n’est pas adaptée à l’objet étudié pour de multiples raisons, dont la plus évidente est qu’une psychothérapie n’est pas une molécule chimique prescrite à un patient. La stratégie d’étude des résultats ne peut donc logiquement pas être la transposition directe des protocoles expérimentaux qui concernent les médicaments
.Du fait de la méthode utilisée (valorisation extrême des méta-analyses et des études de populations randomisées contrôlées, au détriment des études de cas et de processus), les tendances générales qui émergent sont à considérer avec la plus grande circonspection.
En effet,
- de nombreux résultats sont issus de traitements réalisés
dans des conditions très particulières - considérées
comme nécessaires pour la validité interne de la recherche - mais
qui ne reflètent que partiellement ou pas du tout la réalité
clinique.
- d’autre part, ces tendances ne reflètent que la disproportion
du nombre d’études menées d’une approche à
l’autre.
Il faut préciser que cette disparité ne traduit pas tant un désinvestissement
de la recherche dans le domaine des psychothérapies psychanalytiques
(initiée dès leur origine) que deux difficultés inhérentes
à cette approche:
o appréhender un processus dynamique et intersubjectif sans le dénaturer d’une part,
o considérer des situations psychopathologiques sans les réduire à des troubles localisés d’autre part.
Ainsi, dans bien des cas (la dépression ou la schizophrénie, par exemple), l’absence de preuves ne signifie pas absence de résultats, mais absence de recherches réalisées suivant les critères de l’EBM et à partir de la classification DSM.
Un des problèmes de la classification DSM est qu’elle ne prend pas en compte l’évolution de la présentation d’un patient au cours d’une psychothérapie. Or les patients qui s’engagent dans une psychothérapie psychanalytique peuvent le faire dans le contexte d’un trouble particulier (une dépression, des manifestations anxieuses aigues, par exemple), mais leur psychopathologie ne se résume généralement pas à cette pathologie d’appel : elle implique de fait de nombreux troubles et problèmes associés. Cette situation est largement connue et décrite, démontrée par plusieurs études. De façon générale, les études de population – y compris celles menées dans une perspective de recherche génétique – montrent le caractère habituel des comorbidités associant anxiété, dépression et troubles de la personnalité).
Malheureusement, la présente expertise n’a abordé que de
façon tout à fait latérale cette réalité,
ce qui donne évidemment un avantage aux cas « simples » pour
ne pas dire « virtuels », traités explicitement pour un trouble
ou un syndrome limité. Par ailleurs, il est bien connu que les psychanalystes
ne considèrent pas l’amélioration des symptômes comme
un objectif prioritaire, mais comme un des effets de la cure ; en conséquence,
ils ne se sont pas investis dans cette évaluation qui n’est qu’un
des aspects des progrès recherchés, alors que chacun - clinicien
ou patient - peut témoigner des succès obtenus dans ce domaine.
Enfin, de nombreuses souffrances psychologiques et des symptômes variés
ne sont pas inclus dans les syndromes étudiés.
Quand on soigne quelqu’un par psychothérapie psychanalytique,
on traite : des troubles, avec une prévention secondaire de leur rechute,
une personnalité et une situation existentielle (effets traumatiques
et sociaux).
Il y a ici un effet de leurre méthodologique, qui suggère l’idée de la supériorité des TCC dans le traitement des troubles mentaux les plus usuels, mais cela n'a aucune légitimité scientifique.
Les psychothérapies psychodynamiques (psychanalytiques) ont plusieurs
caractéristiques essentielles. Tout d’abord, leur assise
est la complexité : elles reposent sur une théorie générale
commune, mais comprennent différentes variantes qui s’appuient
sur de nombreux sous-modèles développés par les cliniciens
en fonction des troubles et des aspects de la cure qui leur correspondent. De
fait, elles sont adaptées à chaque patient dont
l’engagement et l’interaction avec le psychanalyste sont essentiels.
Ensuite, elles visent des modifications profondes, notamment
quant au rapport que la personne entretient avec le monde, du fait de son histoire
personnelle et des conditions de son développement psychologique. Elles
explorent les conflits internes subjectifs et les conséquences des traumatismes
infantiles ou récents. Leur objectif général est que les
prises de conscience et les acquisitions issues de la relation transférentielle
améliorent le fonctionnement général de la personne et
sa liberté par rapport à ses tendances de base. Autant dire que
leurs objectifs ne se limitent pas à la réduction des symptômes
(même si ceux-ci disparaissent au cours des différents temps de
la cure) ou à une rééducation des conduites, éléments
plus facilement accessibles à la mesure que la qualité des relations
interpersonnelles, la distanciation par rapport aux conflits centraux, la représentation
de soi, les mécanismes de défense, la capacité de réflexion,
etc..
Il est intéressant de noter que c’est dans le cadre de troubles
extrêmement complexes et aux conséquences redoutables - les états
limites (troubles de la personnalité borderline) - que les psychothérapies
psychanalytiques obtiennent leurs meilleurs résultats (niveau 1 de preuve).
Ce résultat traduit à mon avis une réalité clinique,
mais également le fait qu’il s’agit sans doute d’un
domaine particulièrement investi par la recherche, engagée sur
un mode systématique depuis les années 50.
L’évolution méthodologique de cette dernière est
révélatrice : elle montre que les biais initiaux ont été
repérés et dépassés. Nous sommes dorénavant
à un stade où l’on peut non seulement aborder des questions
cliniques précises (par exemple, celle des sorties prématurées
de cure de ces patients difficiles), mais aussi tester une orientation théorique
par rapport à une autre.
Il existe également des résultats démontrés selon les critères de l’expertise pour l'état de stress post-traumatique, le trouble panique en monothérapie ou en association avec antidépresseurs, la dépression (en association à antidépresseurs sur rechutes et fonctionnement psychosocial). Ces résultats ont été démontrés, rappelons-le, en dépit du désavantage majeur produit par la conception de cette expertise. Par ailleurs, nous ne manquerons pas de souligner une nouvelle fois que, eu égard au faible nombre d'études dont nous disposons (du moins suivant les critères exigés), l'absence de preuves d'efficacité n’est en aucun cas synonyme d’inefficacité de la psychothérapie psychanalytique.
Un des aspects qui n’apparaît pas dans la synthèse est le développement récent d’études naturalistes menées en Europe à l’initiative des Associations psychanalytiques. Celle de Leuzinger-Bohleber en Allemagne a étudié les appréciations rétrospectives des patients sur leur psychanalyse ou leur thérapie psychanalytique et leurs effets, 4 ans au moins après qu’elles se soient terminées. Celle de Sandell en Suède est une étude avec groupes contrôles. Elle a fait apparaître des résultats particulièrement importants de la psychanalyse en ce qui concerne la réduction des symptômes. Ces études ont également fait apparaître une acquisition particulière qui est la capacité de réflexion et de distanciation.
De façon plus générale, on trouvera dans la version complète du rapport le résumé de nombreuses études qui n’ont pas obtenu le « label EBM ». Celles-ci sont néanmoins extrêmement intéressantes pour les cliniciens, notamment du fait que les résultats sont présentés non seulement en fonction des objectifs recherchés, mais également du modèle théorique sous-jacent, l’ensemble s’exprimant dans une technique particulière.
Cela fait bien apparaître que toute perspective globale de l’évaluation est non seulement inadaptée, mais qu’elle n’a aucun sens.
A ce stade, il me semble important de souligner l'absence quasi complète d'études en France sur les psychothérapies psychanalytiques (une seule étude portant sur l’intervention psychodynamique brève et deux études franco-suisses sur les facteurs de changement, notamment la formation des psychothérapeutes). Cette situation limite évidemment la portée des résultats obtenus, d'autant que les traitements ambulatoires, notamment en cabinet, sont très développés en France et que la recherche est très peu accessible au secteur libéral.
La recherche est à développer. C’est une des priorités que les pouvoirs publics doivent promouvoir et l’on peut espérer que le travail qui vient d’être fait va davantage en convaincre les décideurs.
Dans ce contexte, il me paraît très souhaitable qu’un investissement important de la recherche soit fait dans ce domaine. Celle-ci pourra s'appuyer sur les méthodes et instruments qui ont mis tant de temps à atteindre leur maturité étant donnée la complexité de l'objet et qui sont clairement décrits dans les chapitres complets de la partie II.
Il s’agit d’un chapitre sur lequel je suis particulièrement intervenu pour en dénoncer les biais méthodologiques et même en demander le retrait. Cette question n’a pas été traitée de façon rigoureuse (ce qui mène à l’absurde). De plus, elle est largement dépassée par les orientations actuellement recommandées dans ce domaine.
Un premier point est à souligner : les études comparées
aboutissent de façon générale à une absence de différence
significative des résultats entre les traitements, ce qui soulève
évidemment de nombreuses questions.
Mais nous sommes ici dans une configuration très différente :
les TCC présenteraient une efficacité dans pratiquement tous les
troubles, et elle serait supérieure à celle des autres approches.
Comment expliquer ce scoop ?
En allant plus loin, les études comparatives « générales
» sont en fait aujourd’hui largement critiquées en raison
de leur absence de prise en compte habituelle des différences qui concernent
- les échantillons de patients (en particulier la sévérité
de leurs troubles et leur environnement psychosocial),
- la compétence des thérapeutes,
- les mesures de résultat et d'autres variables,
- ainsi que le contexte et la façon dont elles sont menées.
De plus, les critères de comparaison majoritairement choisis ne semblent
pas suffisants pour pouvoir considérer qu'il s'agit bien de recherches
d'évaluation comparative, dans la mesure où les objectifs généraux
des psychothérapies ne sont pas les mêmes et qu'il existe une divergence
potentielle des changements observés au niveau des symptômes par
rapport aux gains en terme de santé.
Le choix des critères de sélection des populations (en particulier diagnostiques et symptomatiques), des indicateurs, de la durée des traitements (on arrive ainsi à des absurdités concernant le nombre de séances où les techniques spécifiques n’ont même pas le temps d’être mises en œuvre et à plus forte raison d’être intégrées), le nombre d'études menées interviennent également dans les résultats, ainsi que l'orientation théorique du chercheur. De fait, l'orientation théorique qui réalise le plus de recherches est assurée d'avoir finalement les meilleurs résultats.
Plus les résultats sont globaux, plus ces aspects s'accentuent et l'on
tombe alors dans ce que Barber et Lane décrivent dans l’un de leurs
articles comme des études conduites entre des "marques" de
psychothérapie. "Plutôt que d'examiner les effets de techniques
spécifiques pour des patients spécifiques, ces études ont
cherché surtout à montrer la supériorité d'une école
par rapport à une autre, en partant du principe d'une population homogène
[ce qu'elle n'est précisément pas dans les études retenues].
Cette approche comparative s'est finalement faite au détriment de la
psychothérapie."
Je crains fort que le travail issu de cette expertise dans le chapitre concernant
les études comparatives n’ait pas échappé à
ce travers.
L’important est de savoir quels sont les répondeurs à une psychothérapie plutôt qu’à une autre.
La question devrait effectivement être « Quel traitement, et par quel thérapeute, est-il le plus efficace, pour quel sujet, dans quel problème, dans quelles circonstances, et comment ? » Or cette question a été supprimée de l'introduction à la dernière réunion quand il est apparu clairement que les comparaisons globales basées sur le symptôme ou la nosologie ne peuvent permettre de répondre à cette question. En effet, le symptôme et même l'entité nosologique ne permettent pas de définir suffisamment le patient suffisamment et de savoir à quelle approche il est "répondant".
Autrement dit, il n’est pas impossible de concevoir des études comparatives, mais celles-ci doivent être centrées sur le patient. Il s’agit alors de définir précisément ce qui, chez une personne, fait qu’une approche sera plus indiquée qu’une autre, du moins à un moment donné et/ou pour un objectif particulier.
Certaines recherches ont commencé à aborder la question sous cet angle, en visant une meilleure compréhension des techniques spécifiques et des processus qui distinguent par exemple la psychothérapie interpersonnelle psychodynamique de la psychothérapie cognitivo-comportementale. C’est une orientation plus intéressante et prometteuse que celle qui a été retenue dans cette expertise. Souhaitons qu’une perspective se dessine dans ce sens.
Le travail réalisé est important. Il ne doit pas rester en l’état,
Il est à reprendre et à poursuivre. Aucune décision ne
peut en être actuellement tirée concernant la politique de soin.
Cette expertise n’est pas exempte de reproches. Sa valeur essentielle
est marquer un début et de constituer un état des lieux et une
base de travaux sur lesquels il sera possible de s’appuyer pour s’en
inspirer ou les contester. Compte tenu de la volonté exprimée
par le Directeur Général de la Santé au cours de sa présentation,
elle devrait être le point de départ d’un véritable
développement de la recherche dans ce domaine, notamment pour les psychothérapies
psychanalytiques.
D’autres infos dans les jours qui viennent sur www.techniques-psychotherapiques.org
Dernière mise à jour : 23/12/05
info@techniques-psychotherapiques.org

| 
|